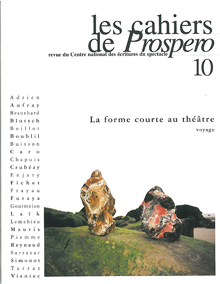
(Roland Fichet, Daniel Lemahieu - échange de lettres publié dans Les Cahiers de Prospéro n° 10, Revue du Centre National des Écritures du Spectacle, mars 2000.)
Première lettre de Roland Fichet à Daniel Lemahieu
16 septembre 1999
Daniel,
Connais-tu Sobel ? Bien sûr, tu connais Sobel, tout le monde du théâtre connaît Sobel. Ça fait un bout de temps qu'il est là, Sobel, dans son théâtre de Gennevilliers, qu'il est là, Bernard Sobel, le metteur en scène. Le lundi 28 juin 1999, au Théâtre de la Cité Universitaire à Paris, Sobel donc, le metteur en scène/directeur du théâtre de Gennevilliers, n'a pas mâché ces mots, il m'a dit — il y avait de la colère dans son ton et dans ses gestes : « Les auteurs vivants n'existent pas. Shakespeare n'est pas Shakespeare tant qu'il est vivant. Débrouillez-vous pour créer vos propres lieux de représentation, vos propres outils de travail. Les auteurs français vivants ça ne m'intéresse pas. Tant que vous n'êtes pas connus à l'étranger pour moi vous n'existez pas. »
Là-dessus il enchaîne sur le purgatoire et le fantôme du père de Hamlet… Sarah Kane passe dans la conversation (elle s'est suicidée il y a quelques mois comme tu le sais) et Sobel, le metteur en scène/directeur du C.D.N. de Gennevilliers, agacé par mon ironie sur le confort des uns et l'inconfort des autres, me cloue : « Les auteurs c'est très spécial, je vais dire quelque chose de saignant : les grands meurent ». Merci Sobel. Tu l'as dit. Il faut mieux le dire pour que ce soit clair : La place de l'auteur dans le théâtre (dans un théâtre) c'est la place du mort. Soit qu'il l'est déjà, l'auteur, mort ; soit qu'on attende ce glissement, cet accident qui fatalement arrive un jour. Le plus vite et le plus brutalement possible c'est mieux. Être vivant pour un auteur c'est un passage inévitable mais gênant ; une situation provisoire, intermédiaire, impure. L'oeuvre est polluée par l'auteur vivant.
Merci Sobel de dire clairement ce 28 juin, au bar du théâtre de la Cité Universitaire, ce que d'autres murmurent dans le dos de ces pauvres auteurs, de ces ridicules auteurs si prompts à demander des bourses, des aides, des résidences, une petite place dans les théâtres… Dehors les pouilleux ! Ça trouble mais ça m'excite assez… Doit-on aller jusqu'à penser que l'oeuvre de l'auteur vivant, dans son pays, tant qu'il est vivant, est forcément mal entendue, mal reçue ? Forcément irrecevable ? Qu'en penses-tu ?
Ne crois pas, Daniel, que je navigue loin de notre sujet, je m'en approche, je m'en approche, mais j'avais besoin de le considérer d'assez loin. (D'où écrit l'auteur de petites formes, pris dans quelle toile, dans quelle nécessité ? )
À propos donc des formes brèves, des petites pièces, des fragments, des éclats de théâtre (notions qu'il faudrait préciser) première hypothèse : L'auteur vivant français est un petit poucet qui sème des cailloux blancs. On ne veut plus de lui. Mais il insiste. Il tient à ce qu'on puisse le retrouver, il balise un chemin pour l'instant indéchiffrable, il se dit qu'un jour on va le chercher, peut-être même se sent-il, se sait-il, indispensable. Il se cache mais… il résiste, l'auteur vivant. Il devient même un as de la résistance. Et du coup il invente de nouvelles figures. Grâce à ses petits cailloux il dessine des formes inédites. Il joue dans la marge et petit à petit jette le trouble, insinue le désordre dans les pages du livre. En contrebandier décidé, il franchit sans cesse les frontières qu'on prétend lui imposer et continue d'inventer le théâtre. L'éclatement du drame en mille petites formes c'est la chance de l'écriture dramatique/théâtrale d'aujourd'hui. Grâce à cet éclatement, grâce à ce jeu vertigineux de la fragmentation, grâce aux multiples petits noyaux de dramaticité qu'elle élabore, l'écriture dramatique/théâtrale française a repris pied dans la modernité.
Je te salue bien.
Roland Fichet
P.S.
1 - N'importe quel auteur aux prises avec le secret des êtres et des choses, aux prises avec ce qui nous regarde, avec ce qui le regarde, aux prises avec ce mauvais oeil qui ne nous oublie pas, pressent dès la première phrase qu'il doit se cacher pour écrire, qu'il doit se cacher pour VOIR. L'auteur tapi au milieu des mots sait attendre, se préparer à bondir, frôler l'in-su, guetter l'appel de l'in-créé. Ce secret qui palpite dans les mots palpite en lui aussi. Ils palpitent ensemble. C'est sa respiration d'écrivain le secret. Pas seulement le secret des mots, de leur agencement, de leurs flux immémoriaux, au-delà encore.
2 - Le fantôme du père de Hamlet... Quel rapport entre le fantôme dans Hamlet et l'auteur dans le théâtre ?
3 - Être vivant c'est l'enjeu. Creuser la brèche du vivant. Fragile brèche menacée par le passé embaumé, cadavérisé, et le futur déjà-cadavre qui envahit notre bouche, notre pensée, le corps individuel et collectif. L'écrivain oeuvre, besogne avec tenacité à cet endroit : le vivant.
Réponse de Daniel Lemahieu à la première lettre de Roland Fichet
27 septembre 1999
Roland,
Ta discussion avec Sobel m'afflige et me terrifie par la suffisance d'icelui et de ceux qui lui ressemblent et tiennent ces méchants propos. Pas tous. Fort heureusement.
Brève histoire de la planète pour redescendre sur terre. Si on ramène à un an les quatre milliards six cents millions d'années passées depuis la naissance de la terre (le premier janvier est à zéro heure), les fossiles des bactéries les plus anciens vivaient le vingt-huit mars. Les premiers organismes multicellulaires, ancêtres des végétaux, apparaissent vers le neuf novembre, l'explosion cambrienne se produisant le dix-huit du même mois. Les mammifères ne suivent que le quinze décembre, tandis que les premiers représentants de la famille des humains descendent de leur arbre le trente et un décembre dans la soirée. Et l'écriture naît dans la foulée bien avant la mise en scène, sans parler des metteurs en scène. J'abrège. Je raccourcis.
Les archives, que constituent les fossiles, montrent que l'histoire de la vie sur la terre a été ponctuée d'extinctions de masse qui, par cinq fois, ont entraîné la disparition de la plus grande partie des espèces vivantes. Si les dinosaures avaient survécu, il y a soixante cinq millions d'années, les hommes n'existeraient peut-être pas ou auraient une apparence très différente. Tu vois, à côté de cette histoire, ce que vaut le combat de l'auteur et du metteur ? Une chose est cependant certaine : l'écriture dépasse de très loin le pauvre metteur en scène qui s'érige en parangon de théâtre. Que ferait-il sans texte ? Et sans les subsides de l'État et des collectivités territoriales et locales ? Et, pour la plupart, sans leurs chers partis politiques dont ils sont les affidés ? Ainsi croient-ils vivre. En réalité, la vie appartient aux morts-vivants de l'écrit, même fossilisés. Je préfère ce statut à celui des vivants-morts de la mise en scène du passé. Mais revenons à nos moutons, dont nous n'étions pas si éloignés.
Les formes brèves, les petites pièces, les fragments, les éclats de théâtre me paraissent être des jeux du cirque. Ne commande-t-on pas des textes de sept minutes à des auteurs pour une scène de un mètre carré zéro sept, étalonnée par un huissier scrupuleux ? [1] N'as-tu pas commandé des « scènes de naissance », pièces courtes, où la liste des auteurs remplissait à elle seule la nécessité de l'écrit ? Cette pratique est un alibi. Qui profite à qui ? Aux commanditaires de ces dites petites oeuvres et aux différentes scènes nationales, et autres officines, qui accueillent ces manipulations d'auteurs vivants. Un zoo d'animaux en voie d'extinction. Une ménagerie de singe du stylo. Un gadget moderniste. Une atomisation du propos qui conforte la position dominante du consortium des employeurs de l'industrie théâtrale, locataires exclusifs et patentés des lieux de représentations et des outils de travail [2]. Cette mitraille de textes les fige dans l'idée qu'il n'y a plus d'auteur. Excepté les morts. Les seuls jugements des directeurs comptent. Leurs seules fantasmatiques prévalent. Leurs choix existent. Le nombre, la litanie des piécettes fait tout à l'affaire. L'écriture est sauvée. Je ne dis pas l'écriture contemporaine, pour ne pas prêter le flanc à ceux qui occupent le théâtre médiatique et prétendent que tout est contemporain, sous-entendu la seule mise en scène des anciens. Si encore la commande était le fruit d'une bataille, de la formulation d'un cri qui s'affirme contre le ventre mou des femmes et des hommes s'enfonçant dans la vie la tête tournée vers le passé. Mais non. Pour être joué petit, il faut écrire petit. Écrire plaisant, gentil, mignon. Les petites pièces les plus efficaces sont souvent des gags. Une pièce, un gag. Un clin d'oeil. Une gaminerie. Elles font rire, sourire. Trois petits tours et puis s'en vont. Aux metteurs en scène, le choix de la grande oeuvre du répertoire reconnaissable rien qu'à son titre. Cela aide à remplir les salles d'enseignants et d'enseignés. Voyez mon incunable ! [3]
Pour ma part, je revendique la recherche des formes comme moteur d'une facture. Écrire c'est inventer des formes. Ce n'est pas écrire des petites formes. À cette affirmation, une exception toutefois : l'apprentissage, l'enseignement. Conduire pas à pas des personnes, par la petite forme, la pièce d'exercice, vers l'intuition créatrice. Je sais : on n'enseigne pas la créativité, on la suggère, on la révèle. Enseigner par l'écriture de la forme brève signifie, pour moi, enseigner l'autocritique et ne pas se satisfaire des petits cailloux blancs informels dispersés par l'auteur, « tout petit poucet » de la composition restreinte. La portion congrue. Tenir le pari de Beckett, que je cite de tête : « mon travail est un corps de sons fondamentaux produits aussi pleinement que possible, et je n'accepte de responsabilité pour rien d'autre ».
Je te salue bien.
Deuxième lettre de Roland Fichet à Daniel Lemahieu
24 octobre 1999
Daniel,
La pièce courte n'est pas, pour moi, d'abord identifiée au gag (ou même à quelque micro-comédie) mais au poème. La pièce courte est la fille du poème. Une de ses filles. L'unité organique de la pièce de théâtre a explosé, comme tu le sais, au cours de ce dernier demi-siècle et dans le même temps la représentation théâtrale s'est émancipée (salut Bernard Dort) de ses formes traditionnelles. Le texte court répond à cette explosion et à cette émancipation. Il prend sa part du mouvement de déconstruction des instances canoniques de la pièce de théâtre et participe à la ré-invention des formes et des modes de représentation, des langages du théâtre d'aujourd'hui. Le texte court fait un pied de nez au drame qui depuis le XVIIIème siècle se prend trop souvent pour la nature même de la pièce de théâtre, pour son essence. Les formes brèves, les petites pièces, les fragments, les éclats de théâtre — je reprends ta liste — déplacent les frontières du texte de théâtre, ouvrent le jeu, provoquent des événements de pensée et des événements de poésie, produisent des combinaisons inédites, s'inscrivent dans des partitions textuelles et théâtrales qui, au bout du compte, redonnent toute sa place à la littérature sur les scènes où s'articule le théâtre de cette fin de siècle (et du suivant, j'espère). Le couple texte/théâtre a la vie dure, je le crois capable de rebonds subtils. De par le jeu mouvant de ses frontières — et des frontières entre les différents arts qui se croisent sur les scènes modernes — il ne peut que tenter des dérapages (pas toujours très contrôlés), des retournements, des métamorphoses. Tant mieux !
C'est dans ce geste de création que s'inscrit le texte court dont je parle, dans cette recherche têtue de grammaires nouvelles. Se déprendre radicalement du naturalisme passe aussi par là. La voie est d'ailleurs ouverte depuis quelque temps déjà : Dada, Kurt Schwitters et le mouvement Merz, Jarry, Gertrude Stein, les absurdistes russes et bien d'autres ne nous ont pas attendus pour jongler avec le court, pour « créer du nouveau à partir de débris » (Kurt Schwitters). Le plaisir des textes brefs ! Le plaisir de la discontinuité, de l'écart, de la fracture visible ! Le plaisir du montage, de la partition ! Le plaisir de jouer avec des architectures mobiles !
Toutes ces pièces courtes, ces fragments comme tu dis, se nourrissent aussi peut-être d'une rupture majeure : l'effondrement des « grands récits », l'écroulement de ces toiles de fond qui font récit pour un peuple, une époque, un monde. Claudel pouvait encore adosser ses pièces au grand récit du christianisme, Brecht au grand récit du communisme, Beckett sent — dans son dos — la toile se déchirer, partir en lambeaux, et de ces lambeaux il fait de l'écriture pour le théâtre. Beckett répond par En attendant Godot, Fin de partie, etc. mais aussi par la petite pièce, par le dramaticule. Le Beckett des petites pièces, des monologues, de Comédie et actes divers envoie la balle très loin. Il sait qu'une des armes du poète face à « l'innommable » qui le défie c'est la justesse d'une forme, la netteté d'un rythme, la radicalité d'une posture. Le Thomas Bernhard des Dramuscules et de Événements, le Heiner Müller de tant de pièces courtes et de morceaux (Pièce de coeur !) et quelques autres la relancent cette balle. Toutes ces dernières années des joueurs d'une grande acuité de regard, d'une grande dextérité entrent sur ce terrain, tricotent leur langue de ce côté-là.
Je commençais ma première lettre par : Connais-tu Sobel ? et je note que dans ta réponse tu n'y vas pas de main morte avec les metteurs en scène. Il faut donc que je précise que j'aime les metteurs en scène, que je travaille avec quelques-uns depuis dix ans maintenant avec un plaisir d'écolier (de chercheur aussi). Nous partageons, je crois, le désir de poésie, le désir de nommer quelque chose qui fuit, qui sans cesse échappe, mais dont la trace sur scène — quand elle surgit — nous émeut, nous bouleverse, nous change peut-être. Le défi du théâtre je ne peux le relever qu'avec les acteurs, les metteurs en scène et d'autres artistes aussi (la liste de ces artistes s'allonge ces temps-ci). L'affirmation de Sobel « Les grands auteurs meurent », je l'ai prise en pleine poire et je crois comprendre un de ses sens (je le suggère dans ma première lettre). Connais-tu Stéphane Braunschweig ? Bon, je ne vais pas recommencer. Il y a une question quand même que j'aimerais poser à Braunschweig : peut-on mettre en scène les oeuvres du passé si on ne se confronte pas aux oeuvres d'aujourd'hui ? Peut-on « passer » les unes si on ne dialogue pas avec les autres ? N'y a-t-il pas dans le présent de la scène quelque chose qui se trame des unes aux autres et dans les deux sens ?
J'en viens au procès que tu fais, dans ta lettre, aux Récits de Naissances devenus pour la période 2000/2001 Naissances/Le Chaos du Nouveau. Le Théâtre de Folle Pensée que je dirige met en jeu toute l'année des textes dramatiques écrits par des auteurs vivants. Toute l'année. Une équipe de huit à seize acteurs animée par plusieurs metteurs en scène creuse cette question semaine après semaine : comment jouer ces pièces qui n'ont jamais été jouées, quelle forme théâtrale leur donner ? Je n'ai pas suscité par hasard cet archipel de textes dramatiques. Les quelques intuitions que j'évoque dans cette lettre le laissent entendre. Le titre Le Chaos du Nouveau fait directement écho à l'effondrement des grands récits constituants… à la violence du réel qui nous étreint, au surgissement de ce réel qui à chaque pas nous déséquilibre Cet archipel se constitue entre deux bords, dans l'espace d'une fracture, dans l'élan d'un mouvement de renversement ou de retroussement : ce qui naît, ce qui meurt. Le très court et le très long sont noués dans ce projet. Ils sont noués, dénoués, renoués. Ce sont des flux aussi ces séries de créations, pas uniquement des constructions, des architectures. Ça frémit comme une robe, ça se découd et ça se recompose autrement dans un autre théâtre, dans un autre espace. Des ensembles articulés type La Nuit des Naissances (durée : 9 heures, cf. la Passerelle de Saint-Brieuc ou Avignon/la Chartreuse en 1993) n'ont pas empêché la représentation isolée de L'Apprentissage de Jean-Luc Lagarce à la Scène Nationale de Quimper ou à Duke University en Caroline du Nord (USA).
Le mot chantier est, semble-t-il, en vogue depuis quelque temps. Hé bien il y a, au Théâtre de Folle Pensée, à Saint-Brieuc, un chantier permanent de dix ans, ouvert en 1991, entièrement voué aux écritures d'aujourd'hui. C'est un chantier discret qui n'en a pas moins produit à ce jour quelques 196 représentations en France et à l'étranger de petites pièces ou textes de théâtre. L'Apprentissage, puisque j'ai cité ce titre, pièce écrite pour les Récits de Naissances donc par Jean-Luc Lagarce n'a rien d'un gag, ou d'une piécette ou d'un gadget, c'est tout simplement un récit d'une grande puissance littéraire et théâtrale. Je peux en dire autant de pas mal de pièces écrites et mises en scène dans ce geste d'écriture et de théâtre. Grâce à elles nous avons bougé notre théâtre, bougé des théâtres, rencontré des publics vifs, en alerte. Le frottement des écritures artistiques nous aimante et nous prenons le risque du déplacement : déplacement du texte, du jeu, de la mise en scène, des spectateurs… C'est bien le moins pour un geste dramaturgique fondé sur le passage. J'espère que le texte composé de ces cent vingt pièces toutes écrites entre 1991 et 2001 ouvrira sur des formes et des sens que je n'imagine même pas. Et il se trouvera au XXIème siècle un théâtre assez fou pour faire de ce gigantesque ensemble de textes courts le plus long spectacle jamais réalisé.
Salutations, Daniel.
Il est minuit. La nuit est paisible à Saint-Brieuc (apparemment !).
Roland.
Réponse de Daniel Lemahieu à la deuxième lettre de Roland Fichet
14 novembre 1999
Roland,
J'essaie d'être clair sur la mise en scène. J'aime les metteurs en scène. Je m'entends parfaitement avec eux, j'apprécie leur travail et l'art du théâtre qu'ils représentent. Je n'aime pas l'hégémonie qu'ils ont tissée dans les circuits de productions. Par exemple, j'estime qu'un auteur, qui aurait à son actif plus de cinquante opus créés, devrait pouvoir bénéficier de subsides lui permettant, durant trois ou quatre années, de poursuivre sa recherche comme cela arrive aux metteurs en scène, dont les créations sont subventionnées par convention portant sur trois ou quatre ans. Au lieu de quoi, à chaque fois, l'auteur doit repasser devant une commission comme si tout le travail effectué était quantité presque négligeable. Plusieurs écrivains de théâtre se trouvent dans cette situation. Dont moi.
Quant à la petite forme, le forme brève, la pièce courte : ce que tu énonces n'est pas faux, mais ne dégage aucun aspect de ce qui pourrait constituer une écriture courte du chambardement. Quels seraient, selon moi, les quelques éléments, parmi d'autres, à mettre en oeuvre pour que cette écriture trouve une efficience autre que celle d'être simplement représentée ?
Je souhaiterais une écriture courte du scandale. Comme les futuristes au début du XXè siècle, retrouver la force et la violence du mélange de formes esthétiques différentes : chorégraphies, sculptures, peintures, musiques de toutes espèces, effigies, marionnettes, masques, vidéos, ordinateurs etc. Politique et art seraient mêlés. L'échange entre la scène et la salle développerait un dialogue direct fait d'accrochages, de bagarres et d'interventions de la police. La police et les C.R.S. enfin de retour au théâtre et pas dans les bistrots à vérifier sempiternellement l'identité d'hommes et de femmes qui n'en peuvent mais. Quand la police entre au théâtre, cela signifie que l'idéologie dominante et son système de représentation se sentent menacés.
Je souhaiterais une écriture courte de l'engagement. Un théâtre de société où l'on assisterait à des scènes d'actualité mettant en cause, par exemple, la caricature des rapports politiques et sociaux. Déjà en 1958, trouble période en France s'il en fut, Arthur Adamov préconisait ce théâtre de société. Constitué de petites formes actuelles, ce théâtre bref traiterait des situations françaises de notre présent, sans en éluder aucune, avec ses paradoxes apparents, ses événements grotesques dissimulant l'impeccable logique des intérêts de classe. Représenter cela le plus littéralement possible, donc le plus grossièrement possible. Moudre gros. Mordre fort. Dénoncer les conséquences néfastes du libéralisme triomphant, les télévisions gavant, chaque jour, les esprits de meurtres quotidiens, la société à deux voire trois vitesses, le quart monde au coeur de nos cités. Puisque les discours gouvernementaux et les exactions capitalistes usent continuellement d'un langage truqué, pourquoi ne pas lutter contre eux à l'aide d'un langage vrai porté par le théâtre ? Et pas de nombrilisme. Bref, écrire des scènes politiques destinées à être données dans tous les endroits où le théâtre ne pénètre jamais. Je ne parle pas ici des cafés, mais des lieux où rien, vraiment rien, du théâtre n'existe. Ces manifestations plastiquement engagées, parfois iconoclastes, devraient pouvoir ouvrir la discussion quand à ce que je représente, en qualité de pouvoir, la possession et la manipulation de langages et de langues de domination.
Je souhaiterais un théâtre de la syncope et de l'exténuation. Tu me parles de Beckett certes, mais tout Beckett. Pas une petite forme parmi d'autres, mais l'ensemble du projet des formes brèves élaboré par le « Grand Sam ». À son exemple, exacerber un univers démesurément vital, glottique et mental. Épuiser le sens, mais par une invention sans relâche d'une nouvelle perception sensible proche de la violence de celui qui aurait un Francis Bacon sur la langue. Les mots de tous au service du physique de tous. Chez Beckett, aucune langue n'est belle. User de la parole sale devient la projection, la visée de toute une existence et pas d'une petite relique d'écriture courte. Chez lui, tout est question de bouche. Et cette bouche n'arrête pas d'éructer par bribes, depuis En attendant Godot. Il faudrait aussi observer avec attention tout ce qui précède cette pièce. Le même auteur, l'auteur même, a entrepris toute sa vie un grand voyage de découverte de micro-dramaturgies proférées. Rien à voir avec l'accumulation de pièces courtes en tout genre que préconisent, sur un thème, les adeptes du petit écrit.
De fait, du scandale, de l'engagement politique, du théâtre de société, de la syncope et de l'exténuation de toute une existence, bref de l'essence d'une écriture courte possible, je ne vois pas grand chose dans les formes brèves défendues ici ou là.
Pour clore cette seconde et dernière lettre, une « circonférence » conclusive en prise directe avec le groupe Merz et Schwiters. Dans mon théâtre — gueuleraient-ils — je réclame la convergence totale de toutes les forces artistiques pour parvenir à l'oeuvre d'art totale. Je réclame l'utilisation de tous les matériaux depuis le soudeur de rails jusqu'à l'alto trois quarts avec des acteurs articulés comme des marionnettes à tringles dans le dos. Je réclame le viol systématique de la technique jusqu'à réaliser entièrement les fusions fusionnantes avec tout. Dans mon théâtre, on lancera des locomotives l'une contre l'autre, on fera exploser des centrales nucléaires pour obtenir de la fumée atomique. On pourra même utiliser des hommes. On pourra même attacher des hommes sur les décors. On pourra même faire jouer activement des hommes et des femmes et les faire parler en bipèdes ou à plumes ou à poils. Dans mon théâtre, dans un silence de mort, on se mettra à accoupler les matériaux. On fera marcher l'homme sur les mains, un chapeau sur les pieds… Je m'arrête. Mais, avant toute chose, je réclame — gueuleraient-ils — la création immédiate d'un théâtre expérimental international pour réaliser l'oeuvre d'art totale. Ceci engendrerait, peut-être, les balbutiements d'une propédeutique de la pièce courte à venir.
Salutations, Roland.
Au lendemain de l'enterrement d'un ami, en dépit de sa mort, j'ai encore du cœur à dire.
Daniel Lemahieu.
Troisième lettre de Roland Fichet à Daniel Lemahieu
31 décembre 1999
Daniel,
« Je souhaiterais un théâtre de la syncope et de l'exténuation (...)
Je réclame la convergence totale de toutes les forces artistiques pour parvenir à l'oeuvre d'art totale (...)
Dans mon théâtre, on lancera des locomotives l'une contre l'autre, on fera exploser des centrales nucléaires pour obtenir de la fumée atomique (...) »
Ta dernière lettre m'a laissé rêveur. Surtout la fin. Cette notion increvable d'œuvre d'art totale a plutôt de la gueule, elle fait assez joli dans le paysage, mais que produit-elle ? Je ne suis pas sûr non plus d'avoir envie d'entrer dans ton rêve de « fusions fusionnantes » même si j'admire l'élan de ta « circonférence » conclusive merzienne. Ça respire un peu la mort, non, cette oeuvre d'art totale que tu dessines à coups de centrales électriques qui explosent et de matériaux qu'on accouple ? Les mots fusion et total sont des mots qu'intuitivement j'ai tendance à prendre avec des pincettes, surtout associés à art. Que peut-on produire de poétique avec ce qui est total ? Pour mon compte c'est le chemin inverse que je sens possible, praticable : à partir de ce qui est partiel, délimité, localisé, saisissable avec précision, on peut ouvrir une brèche sur la totalité du monde (sur l'infini ?), entrer en contact intime avec une sorte de condensation de cette totalité. (Cette fenêtre sur la totalité (ou sur l'infini) qu'est la partie, le fragment, le local, c'est aussi une façon de parler du bref et du long.)
Autre chose m'intrigue : j'ai lu tes pièces, je connais ton goût pour la langue, pour les syntaxes singulières, pour la poétique en un mot ; pourtant dans ta lettre les interventions de la police dans les théâtres ont l'air de te préoccuper beaucoup plus que l'écriture, que la littérature. Dans ton rêve final la littérature a glissé sous la table, mais sans doute est-ce une notion dépassée quand on parle d'oeuvre d'art totale.
Je te lis, Daniel, j'en ai conscience, d'un endroit précis ; lu d'où je suis tu n'y vas pas avec le dos de la cuillère. Tu entres dans le sujet aux manettes d'une pelleteuse et te lances dans une grande entreprise d'élimination et de débordement. Tu accumules dans ton évocation du chambardement nécessaire qui mêlerait art et politique tout ce qui te tombe sous la plume et écrase allègrement ce que quelques uns d'entre nous font aujourd'hui. J'ai bien peur d'entendre les balles siffler à mes oreilles quand tu écris à la fin de ton paragraphe sur Beckett : Rien à voir avec l'accumulation de pièces courtes en tout genre que préconisent, sur un thème, les adeptes du petit écrit.
Tes lettres respirent un jugement sans nuances : ce qui se passe est nul, ce que j'appelle de mes vœux serait grandiose. La posture est commode, trop commode, son défaut de mon point de vue est d'être fondée sur un renoncement. À quoi sert cette disqualification globale doublée d'un rêve apocalyptique qui ne mange pas de pain ? Ne sert-elle pas à s'absenter du présent ? À balayer d'un geste auguste toute proposition opératoire ? Ça convoque pour moi la question de la responsabilité artistique. Ta position critique et ma tentative d'élaboration conceptuelle (cf. lettre précédente) déplacent le débat et c'est tant mieux : de la pièce brève nous sommes passés à la responsabilité artistique. Pour nous au Théâtre de Folle pensée, la responsabilité artistique s'éprouve et se manifeste dans une pratique, une pratique quotidienne qui n'est pas de tout repos : créer du théâtre.
Dans tes deux lettres quand tu fais allusion au cycle de créations Naissances, à cette fabrique d'écritures et de mises en scène que j'anime depuis 8 ans, tu exprimes surtout de la condescendance ; tu n'envisages pas une seconde qu'il puisse y avoir là un frottement écriture/mise en scène doublé d'un frottement théorie/pratique qui produise du théâtre en mouvement. Quand j'ai reçu ta deuxième lettre, j'étais précisément en train d'articuler les créations Naissances/Le Chaos du nouveau, de combiner des agencements, de constituer des figures théâtrales, de faire jouer des échos d'une pièce à l'autre. C'est de là que je saisis les questions que nous remuons. Ces temps-ci mon acte littéraire et théâtral c'est ça : ausculter de près la puissance poétique de chaque pièce reçue, de chaque auteur, construire les conditions de réalisation de cette puissance, les construire matériellement dans un espace donné, dans un temps donné. Dans le théâtre de Saint-Brieuc par exemple (Passerelle/Scène Nationale).
Qu'est-ce que peut le théâtre ? Voilà une question qui m'intéresse, une question que je peux avancer en réponse à ce que tu brandis. Je la pose aux metteurs en scène et aux acteurs avec qui je travaille. Cette question, si nécessaire pour moi, s'adresse aussi aux pièces de théâtre : Qu'est-ce que peuvent les pièces de théâtre des auteurs d'aujourd'hui ? Non pas : qu'est-ce que nous souhaiterions qu'elles soient mais qu'est-ce qu'elles peuvent ? Les pièces de théâtre d'aujourd'hui écrites par des auteurs vivants sont une matière en mouvement. Cette matière en mouvement produit du sens en mouvement. Cette matière et ce sens appellent un acte théâtral lui-même en mouvement, appellent une technicité rigoureuse associée à un esprit de recherche tenace [4].
Cette matière en mouvement exige de rester aux aguets, de se tenir aux aguets, exige un entraînement. Elle invite au déplacement. Il faut se déplacer et déplacer les choses. Ce déplacement c'est toute une science. Voilà ce qui nous mobilise : les agencements inédits, les discontinuités, les ruptures, les ponctuations inhabituelles… Ça produit des effets sur le temps, l'espace, le rythme, la dynamique structurelle de chaque morceau et de l'ensemble. La question du très court, du court, du long, du très long se repose du coup à l'intérieur d'un propos technique, appuyé sur une esthétique, sur une poétique. À quoi se heurte Sobel quand il veut avoir affaire à des oeuvres arrêtées, délimitées par la mort de leur auteur, ou par leur notoriété internationale ? À la matière en mouvement, à la poésie en mouvement. Sans doute veut-il, comme tant de metteurs en scène, un certificat de valeur, une étiquette sur le produit, sans doute ne sent-il pas tout ce que l'indécidabilité de la valeur porte comme puissance de vie. Il y a un lien entre la valeur en suspension d'une pièce toute neuve, vierge de tout commentaire, de toute assignation définitive, et la vie. Ce tremblement de la valeur soulève autrement le désir. On pourrait en parler longuement, on pourrait parler de l'attente, du cheminement, du point de bascule, de la révélation même, de l'intuition du chef-d'oeuvre, des allers-retours de la valeur…
Naissances ? Hé oui naissances. Naissance et création sont liées. Ce sont des mots qui ont une racine commune. Naissances n'est pas un thème c'est une impulsion et un signal. Ça fait signe aux auteurs. Ça signe une position de l'auteur qui articule cette entreprise. L'écriture, l'art produisent de la vie, font naître, font circuler de la vie. Il y a partout de la vie en puissance, de la vie gelée, de la vie prise dans les glaces des mots-cadavres, des idéologies, des armatures sociales et culturelles, des dispositifs politiques, des rapports de force… L'art, la littérature dégèlent, pratiquent dans tout cela des ouvertures, entament, entaillent, déstabilisent, provoquent des apparitions, des surrections… Il y a passage de la vie. La vie passe par là. Cette intuition des forces de l'art, de la littérature, je l'ai traduite par un mot : Naissances. Naissances c'est une tension, un tâtonnement vers ces forces capables de libérer de la vie. Naissances/Le Chaos du nouveau c'est aussi une mise en déséquilibre par les autres, par l'écriture des autres, par le style du voisin. Dans une salle Robert Cantarella explore une pièce de Manfred Karge (Le chien du mur), dans une autre Annie Lucas développe les répétitions d'une pièce de Howard Barker (La douzième bataille d'Isonzo), dans une troisième Stanislas Nordey déchiffre un texte de Philippe Minyana (Description). Les acteurs circulent, creusent des chemins souterrains d'une pièce à l'autre. Une quête discohérente se constitue, comment la faire entendre ? Chaque mise en scène sculpte la force spécifique d'une pièce. Cette force autonome est fondée sur l'irréductible singularité d'une pièce précise. Cependant ces pièces si radicalement séparées sont comme dépliées les unes par les autres. Elles vibrent les unes par rapport aux autres. Cette vibration déborde sans arrêt le cadre d'une pièce, de telle ou telle pièce. C'est aussi cette vibration qui nous mobilise, que nous mettons en scène. Elle ouvre quelque chose.
Du bref je suis passé au vivant. Ou plutôt je les ai curieusement associés (Pourquoi curieusement ?). Devenir vivant c'est un bel enjeu. Pour l'homme et pour la littérature. Quelle que soit la longueur de la pièce.
Voilà Daniel. Je te remercie de l'énergie que m'a donnée ta dernière lettre.
Je te salue amicalement. Demain matin c'est l'an 2000.
Roland Fichet.
[1] cf. Programme de Gare au théâtre, septembre 1999. À Paris et en région existent bien d'autres exemples.
[2] Comment la Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles peut-elle encore faire confiance pour diriger des entreprises culturelles à dominante théâtrale à deux seules catégories de personnes : les metteurs en scène et les « cols blancs », directeurs de scènes nationales et autres théâtres ? Cette position dominante souffre à peine quelques sept à huit exceptions.
[3] Nonobstant, je ne suis pas contre la mise en scène. Je m'insurge simplement contre le fait que pour exister et être reconnu il faut occuper son temps à ausculter à la scène la muséographie théâtrale.
[4] Bien sûr le sens d'une pièce ne cesse pas d'être en mouvement parce que l'auteur est mort et la pièce consacrée. Le sens d'Antigone ou de Hamlet n'est pas assigné une fois pour toutes, sinon il suffirait de représenter à l'infini la même mise en scène. Mais la « matière en mouvement » d'une pièce qui n'a pas d'histoire et dont la place dans la littérature et dans le théâtre n'est pas (encore) désignée n'est pas de même nature.