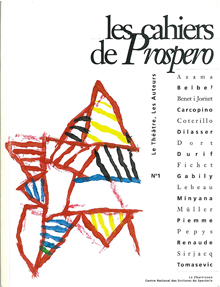
(Article de Roland Fichet publié dans Les Cahiers de Prospéro n° 1, Revue du Centre National des Écritures du Spectacle, 1994.)
(Quatre conversations entre ELLE et LUI à la toute fin de l’année 1993.)
Quelques diagonales tracées dans le champ des formes dramatiques actuelles.
Première conversation – introduction
LUI. – Chère amie, nous y sommes, les livres, les notes, les crayons et boissons à portée de main, nous pouvons ouvrir cette première conversation sur les formes actuelles des pièces de théâtre.
28 décembre. 21h45. Proposez-nous un angle d’attaque.
ELLE. – Formes actuelles françaises ?
LUI. – Françaises principalement. Quelquefois…
ELLE. – La pièce de théâtre s’est dissoute dans l’océan du texte.
LUI. – Je soutiens le contraire. La pièce de théâtre se reconstitue sous nos yeux. Toutes ses instances reprennent du poil de la bête.
ELLE. – Qu’appelez-vous ces instances ?
LUI. – La fable, le personnage, la situation, les didascalies, le découpage en actes et en scènes, les entrées et les sorties.
ELLE. – Instances ! Étiez-vous au Festival d’Avignon ; le dernier, 1993 donc ?
LUI. – Oui.
ELLE. – Où vas-tu Jérémie ? de Philippe Minyana, Enfonçures de Didier-Georges Gabily, Les cendres et les lampions de Noëlle Renaude, Par le cul de Christian Rullier et d’autres pièces encore, jouées pendant ce festival, enfoncent le clou dans le même sens : dispersion des formes dramatiques traditionnelles, explosion de la pièce de théâtre. Dans Enfonçures, par exemple, rôdent juste quelques fantômes de formes dramatiques : morceaux de dialogue, traces de personnages. Si la pièce de Philippe Minyana prenait pour elle la question posée dans le titre, elle répondrait sans doute : « J’erre dans la langue et dans la fiction, j’ouvre des portes à l’aléatoire, je relâche tout jusqu’à mon point d’évanouissement : la mort de la mère. »
LUI. – Cela vous chagrine ?
ELLE. – Des envies de structure complexe, de fable serrée, de tension dramatique me titillent, j’en conviens. Des envies de « pièce hénaurme » qui retraverserait le forêt des formes, la transcenderait dans une œuvre puissamment architecturée. Par où est pensée une pièce ? par les mots ? par le sujet ? par la structure ? Comment sont rêvées les structures par les auteurs dramatiques aujourd’hui ?
LUI. – Qui le sait ? Le théâtre des auteurs que vous venez de citer est peut-être produit (et pensé) d’abord par la langue et par l’écriture… Mais où voyez-vous la destruction des repères à partir desquels s’élabore, s’écrit — depuis les Grecs — la littérature dramatique ? Quelques aventuriers de l’art menacent avec une méritoire audace les « instances canoniques » dont nous parlons, et dans le même temps, d’autres — le plus grand nombre — les respectent, les utilisent (sans les modifier) et développent à partir de là leurs formes et leur monde.
ELLE. – Certains metteurs en scène…
LUI. – Le chœur des metteurs en scène est prompt à s’émouvoir (mais lent quand il s’agit « d’entendre » les auteurs et d’accueillir les écritures d’aujourd’hui). En 1983 — dix ans déjà ! — dans la Cour d’honneur du Palais des papes d’Avignon, deux pièces — Dernières nouvelles de la peste de Bernard Chartreux et Les Céphéides de Jean-Christophe Bailly — chahutaient sérieusement les « instances en question » ; mais la même année, au Théâtre des Amandiers de Nanterre, la pièce de Bernard-Marie Koltès Combat de nègre et de chiens se déployait strictement à partir de ces instances… Que craignez-vous ?
ELLE. – Si plus aucune forme ne s’impose (ou n’est imposée) chaque pièce n’est-elle pas condamnée à re-légitimer les formes (donc les structures, les fonctionnements) qu’elle adopte ou qu’elle invente ? Ne risque-t-elle pas de s’épuiser dans cet effort ? Ne devrait-on pas en faire l’économie comme c’était le cas à l’époque classique ?
LUI. – Quelques pièces, rares, se sauvent et sauvent le théâtre dans cet effort. Les formes signifient. Tout simplement. Heiner Müller dit quelque part : « Pour que quelque chose arrive, il faut que quelque chose s’en aille. » Il faut détruire pour faire surgir du nouveau. Certains auteurs sont en plein saut, ils tentent de franchir une limite, de passer ailleurs. Le théâtre sait depuis toujours ces sauts nécessaires et en particulier depuis Beckett.
ELLE. – Ah ! Beckett évidemment !
LUI. – Traçons une première ligne de démarcation : d’un côté, les pièces « canoniques » arrimées aux « instances » ; de l’autre, les pièces qui dérivent portées par le courant du texte. Le chemin qui passe par Claudel, Brecht, Genet, Beckett bifurque dans au moins deux directions.
ELLE. – Avant d’en appeler à l’histoire du texte dramatique et à ses héros laissez-moi vous dire crûment que beaucoup de textes dramatiques ne sont plus préhensibles, que ce ne sont plus des objets littéraires saisissables, que le théâtre écrit aujourd’hui œuvre à sa disparition, qu’une pièce de théâtre n’est pas la même chose dans le champ de la littérature et dans le champ du théâtre ; que le glissement d’un champ à l’autre a tué « l’œuvre dramatique » , l’a réduite à un pré-texte à théâtre.
LUI. – Qu’on en finisse avec la désinvolture formelle ! C’est ça ?
ELLE. – Hé oui, tendez l’oreille, s’entend autour des scènes la nostalgie d’œuvres qui constituent un sens et dont la saisie (éventuellement critique) soit praticable, ordonnée, reposante.
LUI. – L’œuvre de Bernard-Marie Koltès, elle, a les caractères d’une œuvre qui peut être saisie par le lecteur, le critique, l’université !
ELLE. – C’est exactement pour cela qu’elle s’impose et dure.
LUI. – « Un homme au rêve habité, vient ici parler d’un autre, qui est mort.
Le causeur s’assied.
Sait-on ce que c’est qu’écrire ? »
C’est par ces mots que débute la conférence prononcée par Mallarmé en hommage à Villiers de l’Isle-Adam. Sait-on ce que c’est qu’écrire ?
Cette question est essentielle pour quelques uns et ceux-là ont des pères incommodes que ce soit dans la poésie, dans le roman ou dans le théâtre : Mallarmé, Artaud, Beckett, Müller, Bataille, Blanchot, Butor, Leiris… Sous la poussée de ces écrivains l’œuvre a éclaté, le sens s’est brouillé, le fragment a fleuri, tout s’est décentré. Le décentrement ! Cette notion est au cœur d’une (bonne) partie de la littérature dramatique française d’aujourd’hui.
ELLE. -– Le centre, lui, est au cœur de la réflexion de Bond, par exemple, auteur anglais très présent sur nos scènes (avignonnaises et autres) en 1993 et 1994. Écoutez ce qu’il écrit dans un texte intitulé justement Le centre : « Une pièce de théâtre est faite d’un seul discours qui est répété de façon à explorer son thème toujours plus avant. Chaque personnage s’empare du discours et le retravaille. Ce discours est le discours central (DC), il contient le thème de base de la pièce et aussi la relation que le personnage entretient avec lui — au moment où il l’exprime […]. Idéalement, chaque image — et même chaque réplique de la pièce — passe par le centre de la pièce ; et, bien entendu, les répliques centrales (de chaque scène) sont, pour le personnage qui parle, le plus près possible du centre au moment où il parle. »
Et il ajoute à l’intention des acteurs : « Si l’on ne comprend pas l’importance de toujours jouer le centre, le jeu ne peut pas être central et le public ne peut pas être emmené au centre de la pièce. »
LUI. – Que voulez-vous dire ? Que les notions de déconstruction, de discontinuité, de juxtaposition d’actions autonomes ont dépassées ? Que les théories de l’inachèvement, de la béance du sens, de l’œuvre ouverte ont fait long feu ?
ELLE. – Je pose une question : les textes dramatiques d’aujourd’hui, en France, n’ont-ils pas intérêt à se re-poser la question du « centre » et de l’art de construire ?
LUI. – Les textes dramatiques d’aujourd’hui éprouvent leur rapport à la langue, à l’écriture, à la structure et ils osent.
Deuxième conversation
LUI. – Chère amie, nous y sommes, les livres, les notes, les crayons et les boissons à portée de la main, nous pouvons ouvrir cette seconde conversation. 29 décembre. 22 heures 30.
ELLE. – Les genres — tragédie, drame, comédie — ne vous intéressent plus ? J’aurais aimé pourtant que vous me citiez une bonne pièce par genre. C’est possible ?
LUI. – Rien ne s’écrit plus à partir de ces catégories. Je voulais (vous) parler de la langue, des textes mus par leur langue.
ELLE. – Cependant ; essayez.
LUI. – Tragédie : Combat de nègre et de chiens de Bernard-Marie Koltès.
Comédie : Le jour se lève, Léopold ! de Serge Valletti.
Drame : Agnès de Catherine Anne.
Ces trois pièces utilisent les « instances » habituelles de la pièce de théâtre. Elles les décalent à peine. Des personnages inscrits dans des situations dialoguent à l’intérieur d’une fable qui, scène après scène, se constitue.
ELLE. – Vous le leur reprochez ?
LUI. – Pas du tout. Seulement je veux distinguer ceux qui, à partir de leur lutte avec la langue, débordent ces instances, les pulvérisent quelquefois.
ELLE. – Mais Serge Valletti, mais Koltès, mais…
LUI. – Prenons quelques secondes pour examiner l’entrée que je vous propose. Donc la langue. L’affrontement avec la langue. Valère Novarina. Tout de suite on pense Valère Novarina. L’affrontement avec la langue : Le drame de la vie. Vous ouvrez le livre et dès la première phrase d’Adam cette question : « D’où vient qu’on parle ? Que la Viande s’exprime ? » L’auteur enchaîne sur une série : une procession de noms, une litanie de sons. La langue et son mystère se glissent partout, rebondissent dans chaque phrase du livre, à chaque page. Euphorie de la langue aussi chez Philippe Minyana, ivresse des mots et de la syntaxe dans Jojo, Inventaires, Les guerriers, Chambres. Ces auteurs veulent entendre de la langue, ils se mesurent avec la langue et les plus audacieux la fracassent pour lui faire avouer ce qu’elle recèle. Ils s’attaquent aux mots, bousculent la phrase, modifient ou suppriment les conjonctions de coordination, les articulations, la ponctuation. Les mots charriés dans de vastes coulées textuelles parlent du goût de la langue et de la nécessité de l’ouvrir. Pour ces auteurs la langue est une aventure, la grande aventure quelquefois, ils mettent en jeu le conflit des langues au sein de la langue, le conflit des sens dans le mot et dans le texte. Du coup, il lui ouvrent la porte, au sens : il fuit, s’évanouit, disparaît ou au contraire surgit ; inattendu, inouï. La fuite du sens est une des épreuves à laquelle les auteurs-langue soumettent leurs lecteurs (ou spectateurs). La pulsion de la langue devient le moteur essentiel de leurs textes et ils n’hésitent pas, comme je vous l’ai déjà dit, quand ils le jugent nécessaire, à tordre, voire à détruire les repères classiques à partir desquels s’articule, se construit, s’écrit la littérature dramatique. Ils organisent le dessaisissement à plusieurs niveaux, ils dénoncent le sens unique, le mot fini, la structure close. Sur les ruines des phrases et des formes classiques fulgurent (quand tout cela bascule du côté de l’art et non du côté du chaos) des chocs de sens, des mondes nouveaux, des sensations rares, des sons inouïs.
ELLE. – Novarina et Minyana dans le même bateau : cocasse !
LUI. – Avec Koltès, ils articulent la décennie 83/3. Novarina, seul dans ce monde immense qu’il a créé, est un cosmique de la langue. Philippe Minyana dessine une nouvelle figure : les épiques de l’intime (juste avant les épiques de l’intime, les tragiques de l’intime : Wenzel, Deutsch, Kroetz…).
ELLE. – Poètes, ces dévergondés de la langue ?
LUI. – Comme la plupart des auteurs-langue se considèrent sans doute comme tels mais le travail sur la langue a pour moi des vertus proprement et spécifiquement théâtrales. Du théâtre s’écrit à cause et grâce à cet affrontement avec la langue. Le bruit de la langue fait à lui seul théâtre dans certaines de ces œuvres.
ELLE. – Délimitez un espace littéraire.
LUI. – Je dispose aux quatre coins : Beckett, Perec, Michaux, Joyce.
ELLE. – Pièce de théâtre ou poème dramatique ?
LUI. – Ceux pour qui la langue et/ou l’écriture sont les moteurs de l’œuvre ont tendance à préférer « poème dramatique » , ceux chez qui « la structure dramatique » prédomine adoptent plutôt « pièce de théâtre ». Un mot encore sur le mot. Pour les auteurs-langue le mot est infini, il est autant son et matière que idée, sens. Il faut le déplier, le déployer, le déplacer, le faire exploser, pour le libérer des sens finis qui le menacent, qui risquent de l’épuiser. Les sens multiples libérés par des séries de mots et de systèmes de mots dépliés, découpés, ré-articulés sont la prise première de certains auteurs, ce à quoi ils s’accrochent d’abord (par exemple aussi Christian Rullier).
ELLE. – Qui encore malaxe singulièrement cette matière (la langue) ?
LUI. – Michel Azama par bouffées (Lettre d’Alcibiade à sa psychanalyste), Joël Jouanneau de temps en temps (Le bourrichon), Gildas Bourdet (Le saperleau)… Ceux qui secouent la langue le font avec plus ou moins d’audace et parfois à l’intérieur de formes disons classiques.
ELLE. – Serge Valletti dans Le jour se lève, Léopold !
LUI. – Des amoureux du mort rugueux, du mot mal raboté, âpre, sonore souvent, instillent au creux de la langue les parlers populaires et secouent l’oreille « française » si distinctive, si fermée. Ils luttent contre la mort de la langue et de ses musiques en labourant ses marges, ses zones d’ombre. La langue de Le jour se lève, Léopold ! résonne des parlers du Midi, les déborde, les transcende. Dans Usinage ou Entre chien et loup de Daniel Lemahieu, ce sont les parlers du Nord qu’on entend. Plaisir des idiomes dits pauvres et qui sont si riches ! Que resurgissent les langues occultées et qu’elles envahissent le texte au théâtre !
ELLE. – Au secours un manifeste ! Vous pourrez faire signer tous les auteurs québécois.
LUI. – Chez les Québécois il y a en plus de la langue française du Québec, la confrontation de deux langues. L’articulation ou la confrontation de deux langues au sein du même texte s’inscrit (quelquefois) dans le champ du politique, signifie et souligne une situation politique mais produit aussi des effets de langue féconds. L’écriture théâtrale se nourrit de l’impur de la langue.
ELLE. – Des noms de Québécois.
LUI. – Michel Tremblay, René Gingras, Michel-Marc Bouchard… Mais ils ne sont pas les seuls à croiser plusieurs langues. Ce que je viens de décrire se retrouve, par exemple, dans Djebels de Daniel Lemahieu. Plus généralement le politique imbibe la langue bien sûr.
ELLE.– Avec qui s’interrompre ?
LUI.– Cette lutte avec la langue, cette invention sonore et langagière, je l’entends également chez des traducteurs tels que Françoise Morvan (Désir sous les Ormes d’O’Neill) et André Markowicz (Cœur ardent d’Ostrovski…).
Avec qui s’interrompre ? Avec Pierre Guyotat. Précisément avec Tombeau pour 500 000 soldats mis en scène par Antoine Vitez en 1981 au Théâtre national de Chaillot.
« La langue se charge de boue un seul remède alors la rentrer et la tourner dans la bouche la boue l’avaler ou la rejeter question de savoir si elle est nourrissante et perspectives sans y être obligé par le fait de boire souvent j’en prends une bouchée c’est une de mes ressources la garde un bon moment question de savoir si avalée elle me nourrirait et perspectives qui s’ouvrent ce ne sont pas de mauvais moments me dépenser tout est là la langue ressort rose dans la boue que font les mains » Samuel Beckett, L’image.
Troisième conversation
Chère amie, nous y sommes, les boissons, les crayons, les livres sont à portée de la main. Troisième conversation. 30 décembre. 23 heures 15.
LUI. – Donc le style.
ELLE. – Vieux mot !
LUI. – Vous préférez ÉCRITURE, bien sûr.
ELLE. – D’un côté les jubilants de la langue, de l’autre les maniaques de l’écriture (de la belle écriture !).
LUI. – Les maniaques ! Pourquoi pas les obsédés ? Bon, vous avez sans doute raison, le mot écriture est davantage dans l’air du temps. Le style pourtant, les passionnés du style ! De plus les auteurs-langue sont autant que les autres dans l’écriture jusqu’au cou.
ELLE. – Adoptons le mot écriture. Nous y entendrons écriture/style. Donc nous parlons de posture littéraire.
LUI. – Exactement. À côté des pièces qui travaillent d’abord la langue et qui sont travaillées par elles, celles-ci s’arc-boutent à l’écriture, ne la perdent jamais de vue, l’élisent comme tropisme premier. Ces pièces dialoguent visiblement avec la littérature et avec les formes classiques de la pièce de théâtre.
ELLE. – Le texte-langue dérive, le texte-écriture suit son chemin. Je vous plagie presque !
LUI. – Un chemin balisé par les « instances canoniques » et en particulier par la fable. La narration, les articulations de la fable organisent intimement ce type de pièces.
ELLE. – La langue s’efface, s’atténue, se lisse au profit du discours.
LUI. – Et la phrase s’installe, unité privilégiée. Elle suscite (et s’inscrit dans) des combinaisons narratives quelquefois très savantes. Dans La nuit juste avant les forêts de Koltès une seule phrase, longue, multiple, vorace, inspirée, respirée, réussit à avaler tout le texte. Dans Neige en décembre de Jean-Marie Piemme, plusieurs personnages emploient, pour parler d’eux, la troisième personne du singulier. Les phrases, distinguées, cambrées, présentent les personnages sur un plateau. Dans Enfonçures de Gabily le dialogue avec le poétique et le littéraire se redouble d’un dialogue avec le philosophique. Les effets d’écriture, subtils, savants, abondent. La mise à distance de la forme théâtrale est affichée d’emblée.
ELLE. – Dans certains de ces textes l’éloignement vis-à-vis des formes traditionnelles est donc tout aussi radical que dans les textes-langue les plus audacieux ?
LUI. – Dans certains oui. Rares. Enfonçures : le mot-titre affiche d’emblée les intentions (belliqueuses) de l’auteur. — Dans Chimères et autres bestioles du même Gabily les virages sont pris beaucoup plus en souplesse. — La posture d’écrivain qu’adoptent le plus souvent les auteurs-écriture les arrime à la fiction. Chez eux la fiction est consistante, ils ont de bons amortisseurs, tenue (de route) et retenue sont de rigueur. Dans leurs textes courent des séries de décalages vis-à-vis de la structure traditionnelle, des amplifications formelles, des déplacements qui interrogent nos habitudes, mais on assiste rarement à des changements radicaux de perspective, à des basculements…dans le vide. Ils se nourrissent d’excès mesurés et fonctionnent sur le dévoilement progressif. « L’histoire » reste toujours lisible.
ELLE. – Vous parlez d’ « écrivains » par opposition à « poètes » ?
LUI. – L’auteur-écriture joue souvent sur deux tableaux à la fois, quand ce n’est pas trois, il met volontiers en tension écriture romanesque et écriture poétique et aussi formes théâtrales et formes romanesques. Quelquefois dans ces pièces sont articulées de longues séquences compactes (des monologues souvent) et des dialogues rapides. On trouve cette construction par exemple chez Eugène Durif, Joël Jouanneau, Daniel Besnehard, Noëlle Renaude, Hubert Colas. Dans au moins deux textes de Noëlle Renaude, L’entre-deux et Rose, La nuit australienne, cette construction poussée à l’extrême installe une césure centrale : dans la première partie un long texte couleur « roman » , dans la seconde un dialogue à deux personnages roulant de courtes répliques, couleur « théâtre » . Quelques-uns comme Daniel Danis dans Cendres de cailloux ou Jean-Yves Picq dans Partition distribuent la fiction en monologues successifs (au loin, le souvenir de Tandis que j’agonise de W. Faulkner…).
ELLE. – D’autres gravent leur sujet dans le continu d’un monologue unique (forme parfois très proche de la nouvelle) : La dent noire d’Yves Reynaud, Exécuteur 14 d’Adel Hakim, Le rôdeur d’Enzo Cormann…
Chez les auteurs-langue l’histoire est détruite ?
LUI. – Pas souvent. Rassurez-vous. Quand elle s’emballe la langue dévore le discours, mute et transmute sous nos yeux mais le monstre s’emballe rarement.
ELLE. – La consommation du texte-écriture est plus paisible.
LUI. – Peu de blessures, quelques cicatrices.
ELLE. – Une peau plus lisse.
LUI. – Des dialogues qui roulent.
ELLE. – Ah ! des dialogues. Je croyais que vous alliez nous dire que les dialogues s’estompaient, disparaissaient chez les uns et chez les autres.
LUI. – Beaucoup d’auteurs sur ce versant de la montagne se distinguent par leur insistance sur le dialogue : Catherine Anne (Une année sans été), Enzo Cormann (Sang et eau), Louis-Charles Sirjacq (Sur le trottoir), Yves Nilly (Remarques sur l’horizon et ses habitants), Jean-Marie Besset (Ce qui arrive et ce qu’on attend), Michel Azama (Croisades), Jean-Marie Piemme et bien d’autres… Le dialogue — qui préserve la dialectique — est une instance forte du texte-écriture. Il se nourrit de la conversation (cf. Lire le théâtre contemporain de Ryngaert page 106 et suivantes), côtoie le conte qui, porté par la recherche de nouvelles formes de récits, fait un beau retour (par exemple dans Histoires d’amour, derniers chapitres, de Jean-Luc Lagarce), et se régénère dans le mythe, de nouveau chaudron prodigieux, grâce en particulier à Heiner Müller. Dans certaines pièces telles que L’arbre de Jonas d’Eugène Durif, il revient décalé, assourdi, distancié, structure étirée traversée d’échos, de respirations longues.
ELLE. – Dans ces textes, même quand le théâtre s’éloigne demeure son ombre.
LUI. – Les « tragiques de l’intime » pour reprendre une expression avancée lors de notre précédente conversation souvent sont des ingénieurs du dialogue. Certains manient une écriture très délicate. Dans Dissident il va sans dire de Michel Vinaver…
ELLE. – Intime ou quotidien ?
LUI. – Les auteurs de théâtre dit du quotidien en orientant le projecteur sur le quotidien non spectaculaire ont éclairé des zones triviales (interdites ? ) de l’intime et inventé de petites tragédies poreuses. Drames et tragédies de l’intime sont découpées avec minutie dans Boucherie de nuit, Mado de Wenzel, Dimanche, La bonne vie de Michel Deutsch, Arromanches de Daniel Besnehard…
Sur ce territoire de l’intime on trouve ensuite Catherine Anne (Tita-Lou), Noëlle Renaude…
ELLE. – Épique ! Je la revendique dans la catégorie des épiques de l’intime. À côté de Philippe Minyana.
LUI. – Cet épique purgé du propos politique est bien peu brechtien.
ELLE. – La fable politique est en sommeil. Sous la pression des problèmes du temps elle fait irruption sporadiquement (par exemple dans Le printemps des Bonnets rouges de Paol Keineg ou dans la pièce de Fatima Gallaire Ah ! vous êtes venus… là où il y a quelques tombes — devenue au Théâtre de Nanterre Princesse) mais en général elle se voile, pudique, dans le tissu des mots (ou dans leur déchirement).
LUI. – Tragiques de l’intime, épiques de l’intime…
ELLE. – Et pour finir la ronde ?
LUI. – Peut-être les ludiques de l’intime ! Elizabeth Mazev (Les drôles), Olivier Py (Les aventures de Paco Goliard).
ELLE. – Trêve d’intimité !
LUI. – Hé ! Hé ! grâce à eux la petite parole dépouillée des haillons de Zola et de Strindberg s’allume de lyrisme.
Quatrième conversation
Chère amie, nous y sommes…
Cher ami, nous y sommes… 31 décembre. 23 heures 59.
LUI. – Donc la fable.
ELLE. – La structure dans laquelle elle se moule ! Vous parliez de guerre du sens ; expression hardie !
LUI. – C’est un angle d’attaque… Cette guerre du sens présente dans le texte de théâtre depuis Beckett, Ionesco, Sarraute, Pinget, organise la dénonciation d’un sens qui serait le bon, l’unique, lézarde toute vérité et prend finalement le visage d’une guerre contre le sens. La mise en fuite du sens consistant, du sens qui idéologiquement consiste (donc insiste) est le fil rouge qui relie toute une série de pièces qui hachent le sens et dans le même mouvement la fable. Toute une esthétique de la faille, de la rupture, du fragment, du chantier, se développe sur l’éclatement du sens, sur sa dilution dans la sensation, sur sa dispersion dans le poudroiement sonore et dans de savants jeux de rebonds et de renversements. L’œuvre fonctionne alors sur des sens proliférants, sur des sens qui accouchent d’autres sens, sur des sens déchirés, incertains, fugaces. L’enjeu de cette guerre du sens : signifier le réel autrement, relever son empreinte même dans le sens en fuite, y débusquer la tragédie de l’être.
ELLE. – Exeunt Sartre, Camus, Giraudoux…
LUI. – Disons que l’époque ne leur est pas propice… Enfin jusqu’à ces derniers temps.
ELLE. – Partout des trous dans ces pièces modernes, disons post-sartriennes, quelle gymnastique pour les parcourir !
LUI. – Toute pièce de théâtre est par structure pleine de trous. Lacunaire est l’écriture dramatique. Entre deux répliques il y a un trou, entre deux séquences, deux scènes, deux actes il y a un trou…
ELLE. – Entre deux personnages, entre l’acteur et le personnage, entre l’acteur et le metteur en scène, entre l’auteur et l’acteur, entre l’acteur et le spectateur, entre la scène et la salle…
LUI. – Eh oui, partout des lacunes, des trous à jouer, à franchir…
ELLE. – Et là deux camps se forment. Ceux qui construisent des ponts, des passages et ceux qui comptent sur l’agilité du lecteur et/ou du spectateur.
LUI. – Ceux qui prêchent pour la nécessité et ceux qui prêchent pour le hasard (organisé).
ELLE. – Ceux qui vous prennent par la main et ceux qui vous donnent un coup de pied au cul pour vous aider à bondir.
LUI. – Une pièce peut tendre vers la bouclage serré de son sujet, elle peut au contraire organiser l’inachèvement et avouer sans cesse qu’elle n’est que fragments, morceaux, débris, qu’elle avance vers des précipices toujours plus profonds et que de vertige en vertige, elle nous entraîne vers l’infranchissable, vers la béance (fatale).
ELLE. – Michel Vinaver.
LUI. – Plus que tout autre, Michel Vinaver a, dans son œuvre théâtrale, exploré et maîtrisé cet éclatement du sens, des dialogues, des structures, tout en se tenant obstinément dans le champ d’un théâtre connoté comme tel et constituant, dans chaque pièce, un tissu narratif conséquent. Il creuse les trous comme personne, mine les systèmes narratifs et fictionnels du théâtre, multiplie les accidents, les ruptures, les cassures. Dans Théâtre public de novembre-décembre 1993, Bernard Schaetti consacre à Michel Vinaver un long article titré « Un théâtre de l’ironie » . Citons deux passages de cet article qui analyse en particulier La demande d’emploi (1972) :
1. « On le voit : l’entrelacs est un mode d’organisation textuel difficilement compatible avec les lois de la construction du récit ; la fragmentation des dialogues et leur enchevêtrement presque inextricables entraînent un éclatement du temps et de l’espace de la fiction. De fait, Vinaver décrit son montage comme une « structure polyphonique » . »
2. « Ainsi ce que j’ai appelé la réponse de Vinaver au récit nous apparaît des plus périlleuses : cherchant une voie oblique, il explore le discours, ses ruptures, ses lacunes et opte résolument pour la fragmentation et la polysémie. »
ELLE. – Et à l’endroit où s’arrête Michel Vinaver, par exemple dans La demande d’emploi, qui prend le relais ?
LUI. – C’est un précipice. Pourtant d’autres ont suivi des chemins encore plus fracassants, si l’on peut dire, pour la pièce de théâtre.
ELLE. – C’est possible ?
LUI. – Les trous, de plus en plus avoués, infranchissables parfois, ont dans nombre de cas fait exploser la pièce de théâtre. Ils ont propulsé dans le champ du théâtre des matériaux, des fragments, des blocs de texte que (seule) la décision de l’auteur permet d’identifier comme « texte dramatique » . Pour sortir du cadre francophone, Heiner Müller par exemple nous propose des blocs de textes polymorphes qu’il inscrit dans le champ du théâtre (La bataille, Libération de Prométhée, Héraclès II ou l’Hydre, etc.).
ELLE. – Les courtes fictions de Thomas Bernhard réunies sous le titre Événements sont-elles des textes de théâtre ?
LUI. – Bien sûr, si Thomas Bernhard le dit.
ELLE. – Dans certaines pièces les morceaux qui composent l’ensemble ne sont ni ajustés, ni ajustables ; morceaux autonomes, le lieu de leur unité c’est l’ensemble thématique, le livre ou la scène. Des textes posés les uns à côté des autres désignent le caractère brut de la construction (ce qui ne veut pas forcément dire aléatoire ou désinvolte). Dans Violences à Vichy, Bernard Chartreux, comme s’il revenait d’une fouille archéologique ou d’une expédition, dépose et dispose dans le cadre thématique une série de « regards » sur les années Vichy. À une énumération généalogique (race) succède un fragment de cérémonie, auquel succède Mémoires d’un homme du peuple (I), etc. (Dans Mémoires d’un homme du peuple (III), l’homme du peuple recense les cadeaux offerts au Maréchal qui se trouvent sur la Table des provinces françaises… Énumération précise, longue, efficace, ahurissante. Là aussi, surgit et s’impose une forme.) — Petite remarque : l’énumération est devenue une micro-forme à elle toute seule. Les formes promues par Georges Perec et Peter Handke (Prédiction) ont des héritiers.
Toute la pièce peut aussi prendre la forme d’un fragment, morceau d’un tout non encore émergé ou trace d’une architecture plus vaste qui s’est effondrée. La dernière pièce de Pascal Rambert, De mes propres mains, peut être saisie de cette façon.
ELLE. – Une citation ?
LUI. – Oui. D’un texte de Bernard Chartreux. À propos de Violences à Vichy, créé en 1980 au Théâtre national de Strasbourg (mise en scène : Jean-Pierre Vincent) :
« Qu’il me soit permis à ce propos de citer mon travail sur Vichy. Pour des raisons (pseudo) biographiques, la période de l’Occupation (40-44) m’intéressait beaucoup. Je la trouvais à la fois délicieuse (notre prime enfance) et répugnante, je lui trouvais une « odeur » , un « parfum » qui n’appartenait qu’à elle, et c’est cette odeur, ce parfum que j’avais envie de restituer. Sans doute m’eut-il été possible d’inventer situations et personnages à l’occasion desquels cet « esprit de l’époque » aurait été perceptible. Mais à quoi bon s’encombrer de ce genre de superstructures, sinon pour sacrifier aux lois du genre, et de la sorte nécessairement passer à côté de ce qui était ma visée première. Je disposais par exemple d’un abondant matériel : photos, affiches, images, objets, lieux, itinéraires, emblèmes, discours, paroles historiques, mythologiques, chansons, reportages, proclamations, généalogies, légendes…, dont bien sûr il n’était pour moi ni question de faire un montage documentaire, ni de les couler dans le moule d’une fable personnageante à laquelle ils auraient apporté le sceau de l’authenticité, mais de les soumettre au travail d’appropriation-manipulation de l’écriture, à charge pour elle d’en extraire et exalter l’essence […] Pour autant, les personnages n’étaient pas exclus du texte et de la scène, mais c’étaient des subjectivités ténues et opaques, n’ayant guère d’autre existence que celle que leur conférait la profération de leur flot de paroles. »
ELLE. – J’ai le vertige, pas vous ? Toute cette discontinuité donne le vertige, cette instabilité de la fiction.
LUI. – L’homme — et ce qui le constitue — est au croisement des mots que met en jeu le théâtre. Cette narration brisée, parfois chaotique, dit quelque chose sur l’image que l’homme d’aujourd’hui a de lui-même, sur son identité fissurée, menacée, sur sa mémoire troublée.
ELLE. – N’y a-t-il donc de salut pour une pièce de théâtre que dans l’hétérogénéité ? Des entités hétérogènes qui flottent dans un cadre ouvert ?
LUI. – Caricature ! Cette exploration structurelle croise d’autres façons de marcher (et d’écrire) qui fuient les hardiesses de la discohérence et des formes explosées, qui cultivent le drame et ses enjeux, qui tentent de redonner de la perspective et de l’avenir à la composition dramatique aristotélicienne, qui ne perdent jamais totalement de vue (et de mémoire) Strindberg, Ibsen, les Anglo-saxons, et aussi pour certains Pirandello et Tchekhov. Pensez à Bernard-Marie Koltès (Roberto Zucco), Enzo Cormann (Sade, Concert d’enfers, La plaie et le couteau), Jean-Marie Piemme (Commerce gourmand), Michel Azama (Aztèques),Roger Planchon (La remise)… et de l’autre côté de la Manche à Edward Bond (Maison d’arrêt, La compagnie des hommes)…
ELLE. – Pour moi la rupture radicale, la dispersion, l’explosion, le délabrement renvoient à la folie et à la mort.
LUI. – Rassurez-vous, sur la route du discontinu, la plupart du temps, l’auteur s’arrête, tend des fils, organise des emboîtements, fait du sens. La qualité et la beauté restent liés à la finesse et à la solidité des clôtures qui font d’un texte un ensemble fini, compact, infrangible… Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
ELLE. – Comment donner de la nécessité, de l’urgence, à un texte qui ne s’organise pas autour d’un discours central, d’un noyau central ?
LUI. – À cette question, quelques auteurs répondent par l’invention de nouvelles figures textuelles et par les renversements qu’ils imposent à la fiction. Ils provoquent les lecteurs, les metteurs en scène, les spectateurs à chercher de nouvelles « prises » sur le texte et donc sur le monde (et inversement). D’abord il s’agissait de problématiser la totalité.
ELLE. – De nouvelles figures textuelles ?
LUI. – Par exemple des figures de rupture telles que l’adresse au public (qui n’est pas nouvelle mais qui est fortement réinvestie et quelquefois réinventée dans nombre de pièces récentes). Michel Vinaver dans son livre Écritures dramatiques propose un inventaire de ces figures textuelles et plus généralement une méthode d’analyse des écritures dramatiques. Il distingue en particulier deux types de pièces : la pièce-machine et la pièce-paysage. Dans ces deux types de pièces la structure de la fiction est caractérisée par le mode de progression dramatique, très différent dans l’un et l’autre cas. Citons Michel Vinaver (Écritures dramatiques, page 901) :
« On distingue deux modes de progression dramatique ; l’avancement de l’action se fait :
– soit par enchaînement de cause et d’effet ; le principe de nécessité joue. On a affaire à une pièce-machine ;
– soit par une juxtaposition d’éléments discontinus, à caractère contingent. On a affaire à une pièce-paysage.
On observe, dans certaines œuvres, la coexistence des deux modes de progression. »
Ailleurs, dans le même ouvrage, Michel Vinaver livre deux définitions synthétiques :
« Pièce-paysage : progression par reptation aléatoire »
« Pièce-machine : progression par enchaînement causal (nécessité) »
ELLE. – Michel Vinaver applique cette distinction aux pièces contemporaines ?
LUI. – Aux contemporaines et aux autres. Il soumet à sa méthode d’analyse aussi bien Sarraute et Koltès que Tchekhov et Shakespeare.
ELLE. – Donc l’écriture dramatique reste, à travers les époques, un champ délimité et repérable. C’est une bonne nouvelle.
LUI. – Qui vous a dit le contraire ?
ELLE. – J’avais fini par nourrir des doutes. Il me semble que jusqu’à Beckett les pièces témoignaient de l’art de construire, constituaient cet art. Maintenant…
LUI. – Jusqu’à Beckett ça veut dire quoi ? Jusqu’à Genet (dans Les paravents il y a tout !) ? Jusqu’à Koltès ? Toute pièce est un système, toute pièce articule, architecture et hiérarchise des micro-structures (le mot, la phrase, la scène…) dans un ensemble qui cherche un équilibre, voire une harmonie, et ce système dialogue avec les fonctionnements sociaux, relationnels, communautaires dans lesquels est immergé l’auteur.
Tout à coup elle se tait.
Voici ce qu’elle ne parvient pas à dire :
(ELLE) : Toute pièce a une structure bien sûr mais j’ai le sentiment que le comportement des metteurs en scène-démiurges a eu des conséquences sur le comportement des auteurs qui en sont venus à livrer davantage des matériaux qu’une pièce de théâtre. Les metteurs en scène se considèrent comme les architectes du spectacle et se veulent au bout du compte les véritables maîtres d’œuvre de l’organisation intime de la pièce jouée.
Finalement elle murmure :
ELLE. – Je rêve de structures si raffinées que des combinaisons jusqu’alors inimaginées redéploieraient le monde dans le livre et sur la scène. Je rêve de cathédrales dramatiques.
Alors il pense à Proust et se demande :
(LUI) : L’œuvre doit-elle être structurée comme une cathédrale ou comme une robe ?